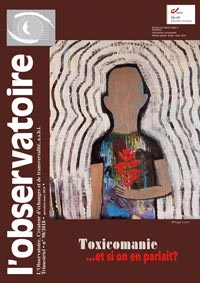n° 51 - 2006
Prévention des Assuétudes (n° double 51-52)

Les données épidémiologiques laissent voir une augmentation de la consommation de produits licites et illicites chez les jeunes mais également au sein d’une population adulte plus hétéroclite et moins marginalisée que ce que nous porteraient à croire nos habituelles représentations. Ainsi, les assuétudes gagnent du terrain malgré les interdits, les mises en garde, les messages préventifs que ceux-ci jouent sur le registre de la dissuasion et de la peur, ou sur celui de la promotion de la santé et du bien-être. Ce dossier se propose d’interroger les pratiques de prévention développées en Belgique, en France, en Suisse, au Québec et présentées lors du premier Congrès international de la Francophonie en Prévention des assuétudes, organisé à Liège en mai 2006.
Éditorial
Les données épidémiologiques laissent voir une augmentation de la consommation de produits licites et illicites chez les jeunes mais également au sein d’une population adulte plus hétéroclite et moins marginalisée que ce que nous porteraient à croire nos habituelles représentations. Ainsi, les assuétudes gagnent du terrain malgré les interdits, les mises en garde, les messages préventifs que ceux-ci jouent sur le registre de la dissuasion et de la peur, ou sur celui de la promotion de la santé et du bien-être. Ainsi, les assuétudes interpellent, questionnent, et la manière de les appréhender, approcher, considérer est aujourd’hui au coeur de débats qui dépassent le champ de la santé ou de la sécurité publique car ils concernent notre vision du monde, nos manières de vivre chacun et de construire ensemble la société.
Ce dossier se propose d’interroger les pratiques de prévention développées en Belgique, en France, en Suisse, au Québec et présentées lors du premier Congrès international de la Francophonie en Prévention des assuétudes. Organisé à Liège, en mai dernier, par la Province de Liège et la Communauté française Wallonie-Bruxelles, ce congrès a permis un brassage d’idées qui touchent tant aux concepts qui sous-tendent la prévention qu’aux stratégies, programmes, actions, outils qui en sont la mise en oeuvre. Des quelques 120 contributions qui ont émaillé les trois journées qu’a duré ce congrès, une trentaine ont été retenues pour constituer ce dossier qui compte 136 pages, soit le double de ce qu’il en compte d’ordinaire.
Côté concepts, on remarquera le pluriel traduisant d’une part l’évolution des mentalités et des approches et donc, somme toute, une constante remise en question, et d’autre part, leur juxtaposition persistante. Ainsi plutôt que de parler d’assuétudes ou d’addictions, on parle de dépendances que l’on invite à considérer autrement, avec un éclairage différent, moins froid, moins cru, plus humain avec des ‘moins’ mais aussi avec des ‘plus’ car la dépendance renvoie à une condition essentielle de l’humanité : la nécessité, le besoin de se relier aux autres. Cependant, suivant l’endroit d’où on pense, d’où on parle, d’où on agit, suivant les objectifs visés, avoués ou tacites, l’éclairage prend des nuances très différentes, tantôt santé, tantôt sécurité, tantôt éducation, tantôt répression. Que vise-t-on en fin de compte ? La prévention, la réduction des risques, la bonne santé, la responsabilisation, la sanction... La juxtaposition semble de mise partout en Francophonie et, invariablement, elle crée, çà et là, des conflits, des malentendus, des blocages...
Côté stratégies, les questions ne manquent pas non plus. Faut-il une seule stratégie pour toutes les addictions, y compris celles sans substances, comme par exemple, le jeu ? Ou encore faut-il une seule stratégie pour tous les publics ? Ici non plus, les réponses ne sont pas unanimes mais il est clair que tant pour les approches globales que pour les approches ciblées, des études doivent être menées pour éviter qu’elles ne produisent des effets inverses ou des effets pervers tels que repérage, stigmatisation, dérapage...
Côté outils, il en est une panoplie mais nous avons surtout retenu qu’ils doivent être pensés dans le prolongement des questions qui sont à se poser en amont : quels sont nos référentiels, quels nos objectifs, quels nos moyens... Parmi ceux-ci, nous voudrions relever celui qui consiste à créer des partenariats car il génère des moyens supplémentaires et des économies d’échelle mais aussi parce qu’il oblige à mettre à plat les représentations de chacun, à dissiper les malentendus, à créer de la cohérence transversale et/ ou verticale... Nous voudrions enfin évoquer le fait qu’il est peut-être aussi des outils à inventer ou à améliorer, à savoir des outils de mesure, d’évaluation, d’accompagnement qui permettraient à chaque projet de grandir, d’évoluer, éventuellement de passer la main... Evaluer la prévention n’est jamais chose aisée puisqu’il s’agit de prendre la mesure de ce qui n’a pas été. Il semble cependant que la question soit plus compliquée encore en matière d’assuétudes, sans doute se heurte-t-elle à des conflits, des divergences conceptuelles mais aussi à la réalité très concrète dans laquelle se meut la prévention, celle d’un manque de moyens et de reconnaissance.
Colette Leclercq
Sommaire
– La politique des drogues en Belgique. Pour situer la prévention - Colette LECLERCQ
– La politique de la drogue de la Confédération suisse : le modèle des quatre piliers
– La prévention des assuétudes au Québec. Unis dans l’action - Marie-Claude PAQUETTE, Robert FAULKNER
– Réponse au phénomène des drogues en Europe : vue d’ensemble en matière de prévention
– Aperçu de la prévention des assuétudes en Communauté française de Belgique - Brigitte CHARLES
– Témoignage - Albert MEMMI
– Quelles préventions ? Le choix d’un chemin au creux des champs - Prospective Jeunesse
– Réflexion pour une prévention professionnelle - André THERRIEN
– Repères pour une anthropologie de la prévention- Baptiste COHEN
– La prévention ne rime plus avec exclusion...- Nicolas DU BLET, Fabienne GIGANDET
– Prévention des conduites addictives. Education, lois & interdits - Alain MOREL
– Du bon usage des études scientifiques dans la prévention des assuétudes - Dominique BIETHERES, Sabine GILIS
– Emergence du jeu pathologique... Faut-il une seule stratégie pour toutes les addictions ? - Michel GRAF
– De la prévention spécifique des addictions à la promotion de la santé - René ZASLAWSKY
– La prévention primordiale, un concept à actualiser - Nicole STENUIT
– La gestion expérientielle - André THERRIEN
– Drogues, mythes & dépendance. Comment en parler avec nos enfants ? - Line BEAUCHESNE
– De la recherche d’outils à l’élaboration d’un projet institutionnel - Nicole STENUIT
– “Diabolo-Manques”, un outil pour une exploration à la découverte de soi - Sylvie ETIENNE
– Quel temps fait-il à l’école ? Le climat scolaire, facteur de protection - Germain PAUWELS, Isabelle DUMONT
– Cannabis et école. Rôle de l’enseignant & collaboration avec le réseau santé-social - Jean-Chares RIELLE, Paul BOUVIER
– Le cannabis dans la vie d’un adolescent normal, un invité encombrant ? - Alain MALCHAIR
– L’écoute, outil de prévention - Alain BOUCHER
– L’aide en milieu ouvert, charnière entre prévention et promotion de la santé - Véronique DETAILLE
– « Rien ne va plus », la prévention du jeu excessif : un nouveau défi de société - Yaël LIEBKIND
– Le défi brestois : trois jours sans alcool. - Luc DUROUCHOUX, Pierre BODENEZ
– Les professionnels de la petite enfance, « acteurs cachés » de la prévention - Jean-François VALETTE, Denis FONAINE
– Diabolo-Manques : le fruit d’un partenariat Province de Liège & Associations de terrain - Dominique BIETHERES
– La prévention dans les passerelles avec les soins - Monique BOUNAB
– La prévention en milieu rural : articulation entre secteur public et associatif - Ariste WOUTERS
– L’évaluation des projets de prévention des assuétudes - Article collectif
– Evidence based : une base solide pour tendre vers l’excellence dans la pratique de prévention - Marijs GEIRNAERT
– Témoignage - Caroline LAMARCHE
– En guise de conclusion - Propos recueillis par C. LECLERCQ
- 4 numéros qui se suivent
- Prix préférentiel au numéro
- Frais d’envoi gratuits !
- n°124 | Le Social sous le prisme du genre
- n°123 | Questions d’argent
- n°122 | Traumatisme. Causes, conséquences et résilience
- n°121 | La précarité nuit gravement à la santé
- n°120 | Faire place à l’usager
- n°119 | L’intégration, l’affaire de tous
- n°118 | L’indispensable collectif
- n°117 | Où va le métier d’éducateur ?
- n°116 | Devenir parent. Quand tout n’est pas rose
- n°115 | Jeunes "incasables" - Comment mieux travailler ensemble ?
titre
"Binding first" la création du lien et ses médiations, ressorts de l'accroche
retour au sommaire du n°93 "L’accroche" Auteur(s) : Interview par Romain Lecomte de Dr Alain MERCUEL, chef du service d’appui « Santé mentale et exclusion sociale » (SMES) du centre hospitalier Sainte-Anne, Paris Premières lignes : Le service “Santé mentale et exclusion sociale” (…)